DossierLoi Hamon sur la consommation : ce qui a changé pour les entreprises
La loi Hamon du 17 mars 2014, entrée en vigueur le 13 juin dernier, contient de nouvelles obligations pour les entreprises aussi bien dans les relations entre professionnels (B to B) qu'avec les consommateurs (B to C). Décryptage des principales obligations qui s'imposent aux professionnels.
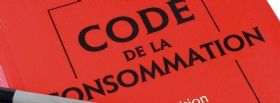
Sommaire
1 Le respect des délais de paiement entre entreprises
L'une des mesures phare de la loi Hamon sur la consommation est la création d'une amende administrative pour punir les retards de paiement. C'est la répression des fraudes (DGCCRF) qui est chargée d'appliquer la sanction. Le législateur a mis la barre haut avec une pénalité de 375 000 euros pour une personne morale, 75 000 euros pour une personne physique. En réalité, ce sont surtout les "poids lourds" de la grande distribution qui sont visés.
La loi s'attaque au dépassement du délai maximum légal (60 jours) mais également "au fait de retarder abusivement le point de départ du délai de paiement". Une manoeuvre dont abuseraient certaines grandes enseignes. Les entreprises sont donc appelées à adapter leurs documents commerciaux au regard des nouvelles dispositions. Les conditions générales de vente doivent stipuler des délais de paiement conformes à la nouvelle réglementation visant à mettre un terme à la pratique des délais de paiement cachés. Sauf stipulation contraire et "pourvu que cela ne constitue pas une clause ou une pratique abusive", la durée de "la procédure d'acceptation ou de vérification" des marchandises ou des services ne doit pas "avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement" et lorsque les parties ont recours à une facture périodique, le délai de paiement "ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d'émission de la facture".
2 Encadrement des délais de paiement
Par ailleurs, la convention récapitulative doit indiquer le barème des prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur avec ses conditions générales de vente, ou ses modalités de consultation, les réductions de prix négociées ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente aux obligations destinées à favoriser la relation commerciale. D'autre part, les entreprises doivent modifier leurs comportements. En effet, les CGV étant désormais le socle unique de la négociation commerciale, le distributeur ne doit pas chercher à obtenir la modification des tarifs du fournisseur avant toute négociation de conditions particulières de vente ou avant la signature d'une convention récapitulative. Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars, soit avant le 1er décembre.
D'autres obligations sont à respecter : le prix convenu à l'issue de la négociation doit être appliqué au plus tard le 1er mars, il est interdit "de passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu", il est interdit de formuler en cours d'exécution du contrat une "demande supplémentaire visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité" et le distributeur doit répondre à toute demande écrite du fournisseur portant sur l'exécution de la convention récapitulative.
Enfin, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent publier des informations sur les délais de paiement non plus seulement de leurs fournisseurs, mais également de leurs clients. Cependant, certains secteurs et contrats font l'objet d'un encadrement spécifique tels que le secteur agricole, le secteur du bâtiment, les contrats de sous-traitance.
Lire aussi : Tout savoir sur la TVA et le dropshipping en 2024
La loi Hamon sur la consommation votée le 17 mars 2014 et entrée en vigueur le 13 juin dernier ne donne pas que des droits aux consommateurs, elle a également pour objectif d'améliorer les relations interentreprises.
3 L'action de groupe, l'une des nouveautés de la loi Hamon
Les associations de consommateurs agréées au niveau national - seules habilitées à déclencher l'action - peuvent dorénavant introduire une action de groupe en dénonçant des manquements de professionnels et démontrant que ces manquements ont causé à des consommateurs un préjudice matériel résultant d'une atteinte à leur patrimoine.
Seules les associations de consommateurs agréées au niveau national, soit 16 aujourd'hui, pourront agir devant le tribunal de grande instance contre le professionnel qui a manqué à ses obligations légales ou contractuelles dans le cadre de la vente de biens ou de services (clauses abusives, publicités trompeuses, etc.) et contre le professionnel à l'origine d'une pratique anticoncurrentielle (entente illicite).
Le professionnel sera condamné à indemniser l'ensemble des préjudices matériels subis par chaque consommateur ayant manifesté expressément sa volonté d'adhérer à l'action de groupe.
Source : www.economie.gouv.fr
L'une des nouveautés de la loi Hamon est la création d'une action de groupe, qui permettra aux clients lésés d'obtenir la réparation du préjudice économique subi.
4 Ce qui a changé pour les e-commerçants
La loi Hamon a modifié les obligations légales des e-marchands, elle renforce en effet les dispositions relatives à l'obligation générale d'information précontractuelle du consommateur dont le non-respect entraînera des sanctions administratives allant jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000€ pour une personne morale. Le professionnel doit ainsi communiquer aux consommateurs des informations complémentaires à celles qu'il devait déjà donner.
Ils doivent fournir au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, un certain nombre d'informations obligatoires, allant des caractéristiques de la marchandise et de son prix aux précisions sur les modalités de paiement et les éventuelles restrictions de livraison. Mais également augmenter le délai pendant lequel le consommateur a le droit de se rétracter en le faisant passer de 7 à 14 jours. ce dernier doit être remboursé dans les 14 jours de sa rétractation. Mentionnez les moyens de paiement acceptés au plus tard au début de la commande.
Les e-commerçants ont pour obligation de définir un délai de livraison d'un maximum de 30 jours à compter de la conclusion du contrat, et de limiter la responsabilité du consommateur en cas de perte ou d'endommagement du bien expédié par le professionnel. Assurez-vous que le contenu et le mode de confirmation de la commande sont conformes à la loi : envoi par courrier électronique de toutes les informations de la commande et lettre de rétractation type. La responsabilité du consommateur ne court qu'à compter de la prise de possession physique du bien, sauf s'il a choisi lui-même le transporteur.
5 Garanties légales et garantie commerciale
Il est désormais impératif de délivrer au consommateur une information précontractuelle, sur un support écrit, relative à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties. Il est également dorénavant nécessaire d'insérer une mention obligatoire dans les CGV précisant l'existence, les conditions de mise en oeuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés et le cas échéant, d'une garantie commerciale. Par ailleurs, la loi prévoit d'allonger le délai de la garantie légale des défauts de conformité à 24 mois.
6 Pratiques commerciales trompeuses
La loi prévoit un alourdissement des sanctions en cas de pratiques commerciales trompeuses. Elle a modernisé les moyens de contrôle et les pouvoirs de sanctions de l'autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ses agents. Des sanctions administratives ont été instaurées comme alternatives à des sanctions civiles et pénales. Les pouvoirs des enquêteurs ont été renforcés (client mystère, injonction administrative, sanction du non-respect des injonctions). Les entreprises doivent savoir ce que recouvrent ces termes de "pratiques commerciales trompeuses".
Les professionnels sont désormais tenus d'une obligation d'information du consommateur renforcée concernant notamment les caractéristiques essentielles des biens et services vendus, le prix, les dates de réalisation ou de livraison.
Sur le même thème
Voir tous les articles Talents


![[Offre d'emploi] La rédaction recrute deux journalistes en alternance](https://cdn.edi-static.fr/image/upload/c_lfill,h_201,w_298/e_unsharp_mask:100,q_auto/f_auto/v1/Img/BREVE/2024/5/335337/Offre-emploi-redaction-recrute-deux-journalistes--L.jpg)





